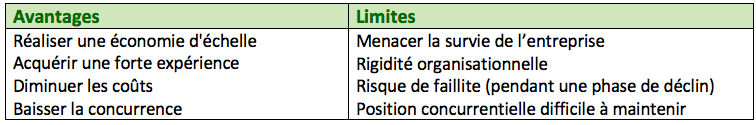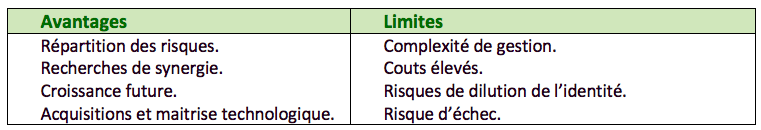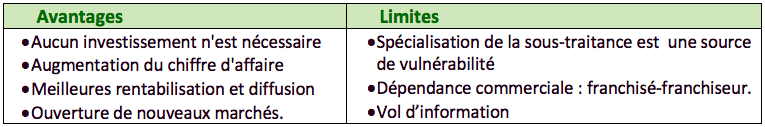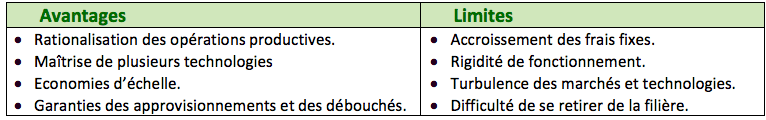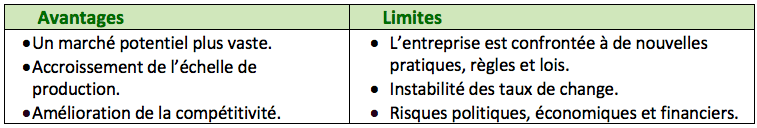1. La stratégie de spécialisation
Elle consiste pour l’entreprise à limiter son activité à des produits fondés sur une technologie unique. En se concentrant sur un seul domaine d’activité, elle cherche à réaliser un avantage concurrentiel décisif.
Types :
Stratégie de pénétration de marché : augmenter le CA avec des produits conçus par l’entreprise sur le marché.
Stratégie de développement du marché : elle passe par la recherche de nouveaux clients.
Stratégie de développement du produit : développer l’entreprise grâce à la vente de nouveaux produits sur le marché.
Avantages et limites :
2. La stratégie de diversification
Contrairement à la stratégie de spécialisation, l’entreprise doit investir dans plusieurs domaines d’activités stratégiques.
Types :
Les diversifications de placement : investir dans d'autres métiers aussi attractifs sur le plan des perspectives de profits.
La diversification de redéploiement : il s'agit de remplacer ou redéployer les ressources de l’entreprise dans d’autres activités.
La diversification de survie : l’entreprise dont les ressources financières sont limitées, doit, pour survivre conquérir d'autres marchés.
La diversification de confortement : renforce l’entreprise en adjoignant des activités complémentaires qui ne nécessitent pas des investissements coûteux.
Avantages et limites :