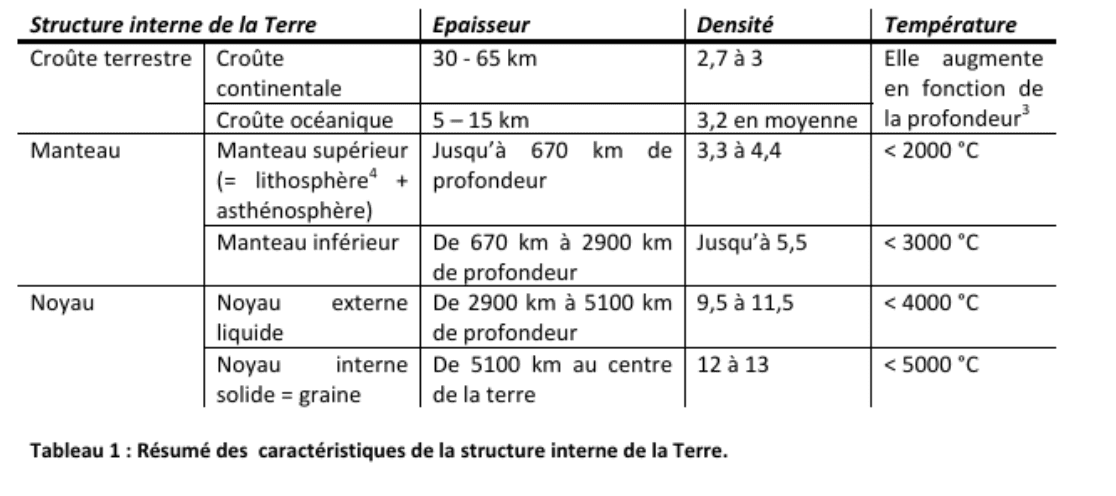I. Les séismes et la structure interne du globe terrestre
Un séisme est un branlement brutal du sol provoqué par l’arrivée d’ondes créées en profondeur à la suite d’une rupture et d’un mouvement brusque de deux compartiments lithosphériques. La conséquence est une libération instantanée d’énergie. Le foyer du séisme (hypocentre) est le point où débute le mouvement, l’épicentre est sa projection sur la surface terrestre et correspond au lieu où la secousse est maximale. Un tremblement de terre peut être superficiel (foyer à moins de 60 km de profondeur), intermédiaire, (de 60 à 300 km) ou profond (plus de 300 km). La rupture se fait par formation d’une faille ou activation d’une faille ancienne.
Intensité et magnitude
Les scientifiques ont défini plusieurs échelles pour classer et caractériser les tremblements de terre : elles se fondent sur l’observation des effets et des conséquences des séismes sur des indicateurs communs en un lieu donné (effets sur les personnes, les objets, les mobiliers, les constructions, l’environnement). Les échelles d’intensité les plus connues sont celle de Mercalli et l’echellle MSK. Ces deux échelles comprennent 12 degrés d’intensité, notées de I (intensité la plus faible) à XII (intensité la plus forte).
La magnitude, introduite par le sismologue Charles Francis Richter, détermine la puissance d’un séisme. Elle se calcule à partir des différents types d’ondes sismiques en tenant compte de divers paramètres comme la distance à l’épicentre ou la profondeur du foyer. La magnitude est une fonction logarithmique : quand l’amplitude des ondes sismiques est multipliée par 10, la magnitude augmente d’une unité.
Les différents types d’ondes : les séismes génèrent des ondes qui se propagent à partir du foyer à des vitesses variables selon les milieux. On distingue les ondes de volume (P et S) qui se propagent dans toutes les directions et traversent la terre, et les ondes de surface (L) qui circulent parallèlement à la surface terrestre.
L’onde P, qui s’est propagée à une vitesse de l’ordre de 6 km par seconde, arrive la première. D’amplitude modérée, elle occasionne un mouvement vertical du sol, moins perceptible que celui accompagnant l’onde S. Elle donne parfois lieu à des manifestations sonores (« coup de canon » pour un séisme profond à courte distance, « grondement sourd » à plus grande distance).
L’onde S arrive après l’onde P, car sa vitesse de propagation est plus faible, de l’ordre de 3.5 km/s. Son amplitude et ses périodes caractéristiques sont plus grandes que celles de l’onde P. Elle s’accompagne d’un mouvement horizontal de cisaillement du sol, fortement ressenti.