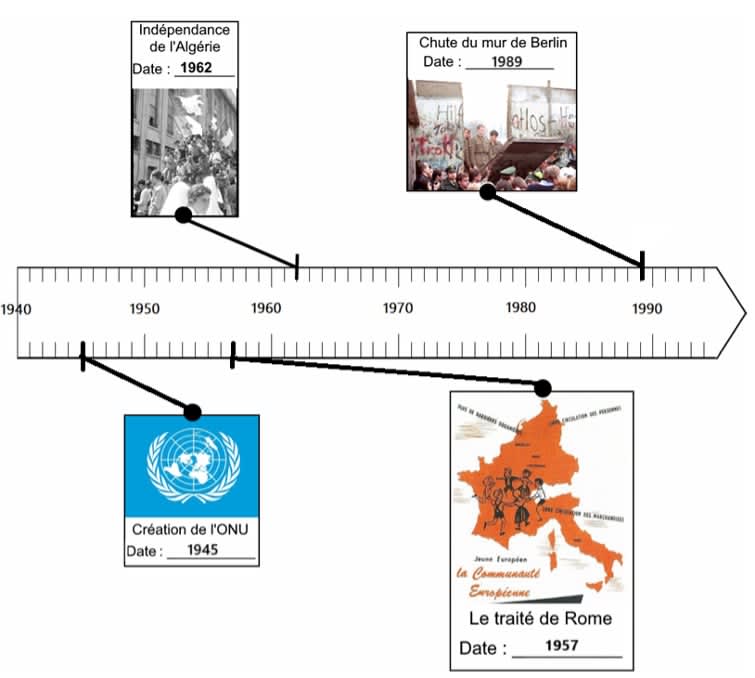Partie Géographie
Document 1
1. L’action présentée a pour objectif d’attirer de jeunes médecins dans le département du Lot.
2. Le département du Lot et la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne sont deux acteurs à l’origine de cette action.
3. On peut relever deux difficultés du territoire auxquelles ces acteurs cherchent à répondre : La population du Lot est plus âgée que la moyenne de sa région et les médecins implantés dans ce département sont 48% à avoir plus de 60 ans.
Document 2
4. Le département du Lot met en avant deux atouts dans sa communication : la nature (forêt et Lot) et l’espace dont jouit chaque habitant.
Documents 1 et 2
5. Frappés par l’exode rural, le vieillissement de la population et la fermeture de services publics, les espaces de faible densité ont cependant de nombreux atouts qu’ils cherchent à mettre en avant. Leur isolement et leur enclavement ont longtemps été un problème. Aujourd’hui, ils sont devenus un gage de tranquillité et d’authenticité, notamment pour les touristes. Les Français cherchent désormais des activités plus proches de la nature. Par exemple, la randonnée en montagne connaît un regain d’intérêt. De même, l’agriculture bio, ou les AOC, sont davantage développées dans les espaces de faible densité.
Les nouvelles problématiques qui affectent les aires urbaines (prix de l’immobilier, congestion du trafic, insécurité ou pollution) ont modifié l’image de ces zones. Par exemple, les prix de l’immobilier dans les zones de faible densité sont entre 5 et 10 fois inférieurs à ceux d’une aire urbaine.
Enfin, un nouveau rapport au travail et à la société a connu un coup d’accélérateur avec les confinements liés au Covid-19 : de nombreux Français se sont adaptés au contexte par le télétravail et parfois des téléconsultations, ce qui résout en partie la problématique de l’isolement des espaces de faible densité.
Ce changement de paradigme donne à ces espaces une attractivité encore fragile mais a provoqué un véritable changement de leur image.
Partie Histoire
La décolonisation est le processus historique par lequel les peuples colonisés sont devenus ou redevenus indépendants. Ces décolonisations ont parfois été pacifiques mais ont aussi parfois donné lieu à des conflits violents. Comment les colonies accèdent-elles à l’indépendance après 1945 ?
Dans certains cas, l’indépendance est obtenue par des négociations. L’Inde accède à l’indépendance en 1947, sous l’impulsion du mouvement nationaliste mené par Gandhi et Nehru. Dès 1929, le Parti du Congrès proclame symboliquement l’indépendance de l’Inde. Dans la foulée, en 1930, le Mahatma initie la « marche du sel », qui oblige le gouvernement britannique à renoncer à l’impôt qu’il avait prévu de collecter. Le Royaume-Uni souhaite éviter un conflit long et coûteux et accorde l’indépendance à l’Inde. Cependant, la partition entre Inde et Pakistan aboutit à des violences intercommunautaires entre Hindouistes et Musulmans.
On peut aussi citer l’exemple de la Guinée. En 1958, De Gaulle veut accorder une forme d’autonomie aux colonies d’Afrique mais Sekou Touré, maire de Conakry, s’y oppose, réclamant l’indépendance totale ou rien. Il rallie la population guinéenne à sa position. Le 28 septembre 1958, le pays rejette par référendum à 98 % la proposition française. Le 2 octobre, la Guinée proclame son indépendance.
Dans d’autres cas, la décolonisation aboutit à de véritables conflits armés. L’Indochine a déjà été le théâtre d’une mutinerie de soldats qui s’est étendue à la population en 1930. Dès 1946, le mouvement indépendantiste vietnamien, le Viet Minh, dirigé par Hô Chi Minh, lance les hostilités. Soutenu par la Chine et l’URSS, le Viet Minh mène une guérilla efficace contre les troupes françaises. La défaite française à la bataille de Diên Biên Phu, en 1954, est décisive : elle entraîne la signature des accords de Genève et le retrait d’Indochine de la France.
En Algérie, colonie française depuis 1830, l’indépendance est aussi acquise après une guerre sanglante de huit ans (1954-1962) qui commence en réalité dès les incidents de Sétif du 8 mai 1945. Le Front de libération nationale (FLN) mène une lutte armée contre la présence française qui se caractérise par un cycle d’attentats et de répression. Cela finit par entraîner la lassitude de la société française et l’adhésion d’une majorité d’Algériens à la cause indépendantiste. Le conflit provoque de lourdes pertes humaines et divise profondément la société française. Il se termine par les accords d'Évian en 1962, qui reconnaissent l’indépendance de l’Algérie.
La décolonisation est un processus mondial qui met fin en quelques années à des empires qui ont duré plusieurs siècles. Il illustre la perte de puissance de l’Europe, l’émergence d’Etats nouveaux et jeunes mais souvent fragiles.
Partie EMC
Document 1
1. Les élèves sont invités à s’engager contre le harcèlement.
2. Les élèves peuvent sensibiliser les autres élèves du collège à cette problématique. Ils peuvent repérer des signes de harcèlement chez leurs camarades. Ils peuvent aussi convaincre les victimes de parler.
Document 2
3. Le prix « Non au harcèlement » permet de faire vivre la valeur de fraternité dans un collège : d’une part il promeut des projets collectifs qui concernent tous les élèves du CP à la Terminale. D’autre part, il vise à favoriser le bien-être des élèves à l’école, à mieux écouter les élèves et à sensibiliser les élèves et les personnels. De ce fait, il renforce les liens entre élèves de tous âges, adultes et membres de la communauté éducative et renforce la fraternité.
Documents 1 et 2
Je souhaite présenter ma candidature pour devenir un ambassadeur du collège contre le harcèlement scolaire. Rien dans mon histoire ne m’y incite pourtant. Je n’ai jamais été victime de harcèlement. Cependant, je ne supporte pas l’injustice. Je me sens même victime à chaque fois qu’une personne est victime. C’est devenu un réflexe chez moi. En effet, que veulent dire égalité et fraternité si on ne s’imagine pas à la place d’une victime ?
J’aimerais donc lancer une première action à l’échelle de notre collège pour lutter contre ce fléau. J’aimerais que le collège lance une campagne d’affichage et de sensibilisation auprès des collégiens et de leurs parents pour rappeler que les plus jeunes élèves n’ont pas le droit d’être sur les réseaux sociaux. Le cyberharcèlement est pour moi l’angle mort des politiques menées contre le harcèlement car il est souvent massif, rapide et invisible. La meilleure façon de s’en protéger, c’est de s’éloigner de ces lieux virtuels.
J’espère que cette action et ma candidature vous convaincront de ma volonté de m’engager pour faire progresser le traitement de ce sujet.
Repérages